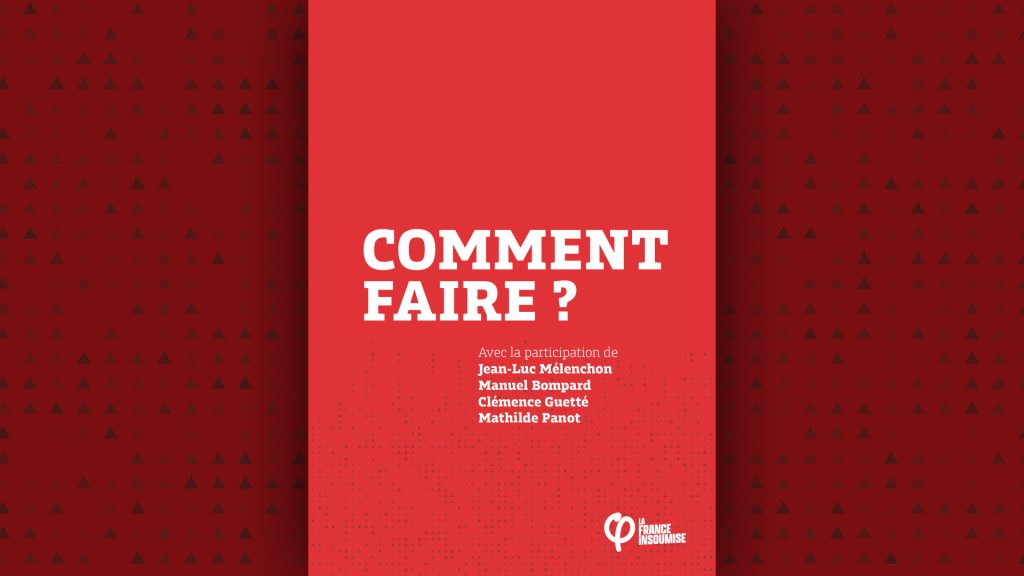Dans l’Insoumission, Jean-Luc Mélenchon analyse les ondes longues de l’Histoire des États-Unis au regard des secousses imposées par Trump au monde et ses conséquences sur l’unité de son propre pays. Retrouvez leur article.
Les rebondissements quotidiens dans l’actualité provoquée par la politique de Trump poussent à un intérêt plus approfondi sur les USA. Il faut penser dans les ondes longues de l’histoire, les composantes de son identité beaucoup plus complexe que l’image d’Epinal folklorique qui en est donnée le plus souvent.
Le moment se prête à y revenir. À vrai dire, la secousse imposée au monde par Trump est aussi, et peut être surtout, une secousse pour son propre pays. Bien sûr, les milieux populaires vont être sévèrement frappés par l’inflation importée avec les nouveaux droits de douane. Mais ce n’est pas tout. Des pans entiers de l’économie s’identifient avec certains des États fédérés. Cela impacte alors la trame même du pays. Quand la Californie menace de ne pas appliquer les droits de douane fédéraux, une autre interrogation surgit avec la surprise. La fédération peut-elle être fracturée par cette onde de choc trumpiste ? L’unité des États-Unis est-elle assez forte pour y résister ? La question peut être posée. Des informations à bas bruit circulent. Récemment, plusieurs mouvements en faveur de l’indépendance ou de la sécession auraient émergé ou gagné en visibilité dans certains États aux USA.
Plusieurs causes se superposent en effet pour fracturer les USA quand les États composant l’Union sont mis au pied du mur de leurs intérêts fondamentaux. La première de ces couches est ancrée dans l’histoire violente de ce pays. Les survivants des soubresauts sont toujours là et leur mémoire collective contient des ingrédients pimentés transmis entre les générations. Ce sont des situations assez diverses. Ce sont par exemple les ressentiments des peuples dans les États volés au Mexique en 1848. Ils représentaient la moitié de la surface de ce pays. Ce sont aujourd’hui les États fédérés de Californie, du Nouveau Mexique, de l’Arizona, du Nevada, de l’Utah et d’une partie du Colorado et du Wyoming. De fait, la langue espagnole est déjà la seconde langue des USA et la première dans certains États. Elle peut devenir aussi la première parlée à domicile avant la fin du siècle.
Mais dans ce registre post traumatique, Il y a surtout les onze États de la guerre de Sécession (1861/ 1865) Ils ont été vaincus par les armes et maintenus de force dans l’union. C’est la Caroline du sud, Mississippi, Alabama et Géorgie, Louisiane, Virginie, Arkansas, Tennessee. Seize États ont ainsi une mémoire historique humiliée à propos de l’Union. C’est une moisissure prête à revenir en surface puisque ces événements n’ont en général pas plus d’un siècle et demi de recul. Les plaies restent vives, même muettes. Les mauvaises paroles de Trump contre la Californie en feu et les insultes contre son gouverneur ont suffi à raviver les sentiment de rejet. Le mouvement indépendantiste qui s’en nourrit a reçu un vigoureux coup d’épaule après les injures et menaces de Trump. Les autorités de Californie ont donné leur feu vert en janvier dernier pour une pétition réclamant un référendum en 2028 sur l’indépendance de cet État. Si c’était le cas, la Californie serait la cinquième puissance économique du monde. La séparation a donc de l’attrait. Mais pour arriver là, la pétition doit d’abord rassembler d’ici le 22 juillet 2025 au moins 5% des électeurs inscrits en Californie. C’est donc une campagne de masse active qui est engagée. Ensuite, une commission composée de 20 membres tirés au hasard commencera à se réunir en août 2027. Elle devra faire un rapport public sur la capacité de la Californie à se gouverner en tant que nation indépendante. Nouvelle extériorisation forte pour ce projet ! Enfin, le 7 novembre 2028, les Californiens devront voter oui ou non à la question : « La Californie devrait-elle quitter les États-Unis et devenir un pays libre et indépendant ? ». « Nous pensons que le moment est désormais propice pour un Calexit. Nous sommes maintenant mieux placés pour le concrétiser qu’en 2016 », a déclaré Marcus Evans, le leadeur de l’initiative à CBS News. Il avait déjà essayé la même procédure lors du premier mandat de Donald Trump, sans pouvoir arriver à l’étape de la pétition. C’est fait dorénavant.
Voyez encore par exemple le Texas. Il avait quitté librement le Mexique pour être indépendant (1836) avant d’être assimilé sans recours possible par les USA en 1845. Le mouvement indépendantiste Texan a trouvé une vraie visibilité. En mars 2023, le représentant de l’État, Bryan Slaton, a introduit un projet de loi visant à ajouter un référendum sur l’indépendance à l’élection de 2024. Sans effet. Mais dix candidats républicains soutenant ce projet ont été élus à la chambre de cet État. Autre exemple dans un autre registre : l’Alaska. Le territoire a été acheté au Tsar de Russie en 1867. Mais la population n’a pas pu donner son avis avant 1959. Alors aujourd’hui l’Alaskan Independence Party milite pour un référendum sur l’indépendance. Selon lui, les alaskiens n’ont pas pu choisir vraiment leur statut politique. Son mouvement plaide pour des droits accrus sur les terres et les ressources naturelles, une réduction de l’ingérence fédérale et une gouvernance autonome. Un sondage récent indique que 36% des résidents de l’Alaska soutiendraient l’indépendance.
Des mouvements de sécession sont aussi signalés en Louisiane et Floride. Ils sont chacun motivé par des contextes historiques et des revendications spécifiques. La Louisiane avait fait sécession des États-Unis le 26 janvier 1861, pour rejoindre les États sudistes confédérés. Les revendications actuelles visent le rôle de l’État fédéral. Sa nullité face à la catastrophe climatique a été avérée. En 2023, un nouveau mouvement politique appelé « Free Louisiana » a été lancé, appelant à l’indépendance. Les partisans de ce mouvement expriment des revendications concernant la représentation politique des intérêts locaux et des revendications culturelles. Ces mouvements reflètent les tensions permanentes dans la mentalité collective contre les gouvernements fédéraux ou de l’État. Ils s’enracinent dans un fond commun du pays. Mais celui-ci, précisément, le pousse pas aux élans solidaires.
L’esprit public nord-américain est fait d’individualisme, de volonté absolutiste de liberté individuelle contre les autorités de l’État et de l’administration quel qu’elles soient. La défense du droit à l’armement individuel si décrié dans le reste du monde procède aussi de cette mentalité. Ainsi la culture profonde de ce pays, l’individualisme et le refus de l’État entrent en résonance avec les pulsions de fragmentation. Il est ainsi depuis quasiment la colonisation initiale par les dissidents protestants de l’Angleterre. Des lors, le liant de l’État fédéral n’a jamais été fondé sur des valeurs assurant ou renforçant la vie commune des composantes de cette nation. Depuis la fin de guerres dites « indiennes » à la fin du dix-neuvième siècle et la fin de stérilisations forcées dans les années 70 le pays vit toujours sur la négation d’un génocide ethnique. Au demeurant, après l’esclavage auquel il n’a pu être mis fin que par une guerre, une politique raciste d’apartheid a duré jusque dans les années 70 clivant les nord-américains, entre eux, d’après la couleur de leur peau. Les mécanismes de solidarité collective sont faibles et sans cesse décriés par la fraction droitière, qui, bien sûr, possède les médias influenceurs. Elles cristallisent donc à chaque fois sur des préoccupations identitaires concernant la représentation politique, la gestion des ressources ou le refus des différences culturelles.
Alors elles peuvent aussi se pulvériser en demandes de sécessions très localisées, dans une logique interne aux USA. Un mouvement récent aux États-Unis montrent la volonté de certains comtés de changer d’État ou même de créer de nouveaux États. Ici le contenu du mouvement semble refléter des données plus existentielles reflétant des divisions culturelles entre les régions urbaines et rurales. Voici quelques exemples notables. Mouvement « Greater Idaho ». Ce mouvement propose que plusieurs comtés de l’Est de l’Oregon se séparent de cet État pour rejoindre l’Idaho. Il estime que ses valeurs conservatrices sont mieux représentées en Idaho. En mai 2024, 13 comtés de l’Oregon avaient approuvé des mesures en faveur de cette initiative. Dans l’Illinois, en novembre 2024, sept comtés de l’Illinois ont voté en faveur de la possibilité de se séparer du comté où se trouve Chicago pour former un nouvel État ! Ce vote reflète une frustration face à l’influence politique jugée écrasante de Chicago sur les affaires de l’État. Il y a aussi la proposition de création du comté de Peconic à New York. Depuis plus de 50 ans, il est question de créer ce comté. Cette proposition concerne les 5 villes les plus à l’est de Long Island qui souhaitent former un nouveau comté en raison de différences culturelles et économiques avec le reste du Suffolk. En 1997, 71 % des électeurs de l’est de Long Island ont approuvé une résolution en faveur de cette sécession. Ces mouvements alimentent les revendications sur la forme de la représentation politique, sur fond de rejet de l’État fédéral.
Ces informations ont retenu mon attention, parce que je vois depuis longtemps combien l’État nord-américain a des caractéristiques de fragilité particulière. Tenons compte de sa brève existence historique depuis son indépendance le 4 juillet 1776. Et retenons que sur ses 249 ans d’existence, ils ont passé 225 ans cumulés en guerre. Ils ont été engagés jusqu’en 2025 dans 401 interventions militaires. Autrement dit, les États-Unis ont été en conflits militaires permanents quasi sans trêve depuis leur création. Tantôt contre les puissances coloniales européennes, tantôt contre leurs voisins, tantôt entre eux-mêmes, comme ce fut le cas avec à la guerre de Sécession ou bien avec des zones entières du reste du monde. La place de la guerre et de l’industrie d’armement est donc bel et bien des composantes essentielles de l’identité des USA. Cela représente un liant national, certes. Mais la vie du pays est continuellement à la limite de l’équilibre du fait de cette relation au monde. Une certaine manière de se sentir inclus par les seuls rapports de domination et de violence est assez profondément incrustée dans la mentalité collective du pays. Il n’est donc pas étonnant que chacun décline pour son coin l’isolationnisme qui prévaut souvent au niveau national. Car la tentation de l’isolement est récurrente dans ce pays et elle y devient vite un invariant d’échelle. Ainsi, le Président Wilson avait été élu Président des États-Unis sur un programme refusant frontalement et durement la participation à la première guerre mondiale en Europe. Une décision qu’il choisit ensuite d’annuler pour rendre possible l’intervention de ce pays. Mais pas avant septembre 1917. De même, en 1940, les États-Unis n’ont-ils pris aucune part à la défense de qui que ce soit en Europe contre les nazis jusqu’à l’agression des Japonais à Pearl Harbor. L’entrée en guerre des États-Unis à partir de là n’a pas empêché qu’ils aient maintenus jusqu’à la dernière limite des relations officielles avec des régimes comme celui des pétainistes en France et combattus jusqu’à la fin l’indépendantisme gaulliste. Les USA ne sont donc pas la nation des livres d’image atlantiste. Le savoir peut aider à prévoir son action. Mais aussi à s’interroger sur son futur à l’heure ou il se montre capable d’une telle extrême-droitisation.