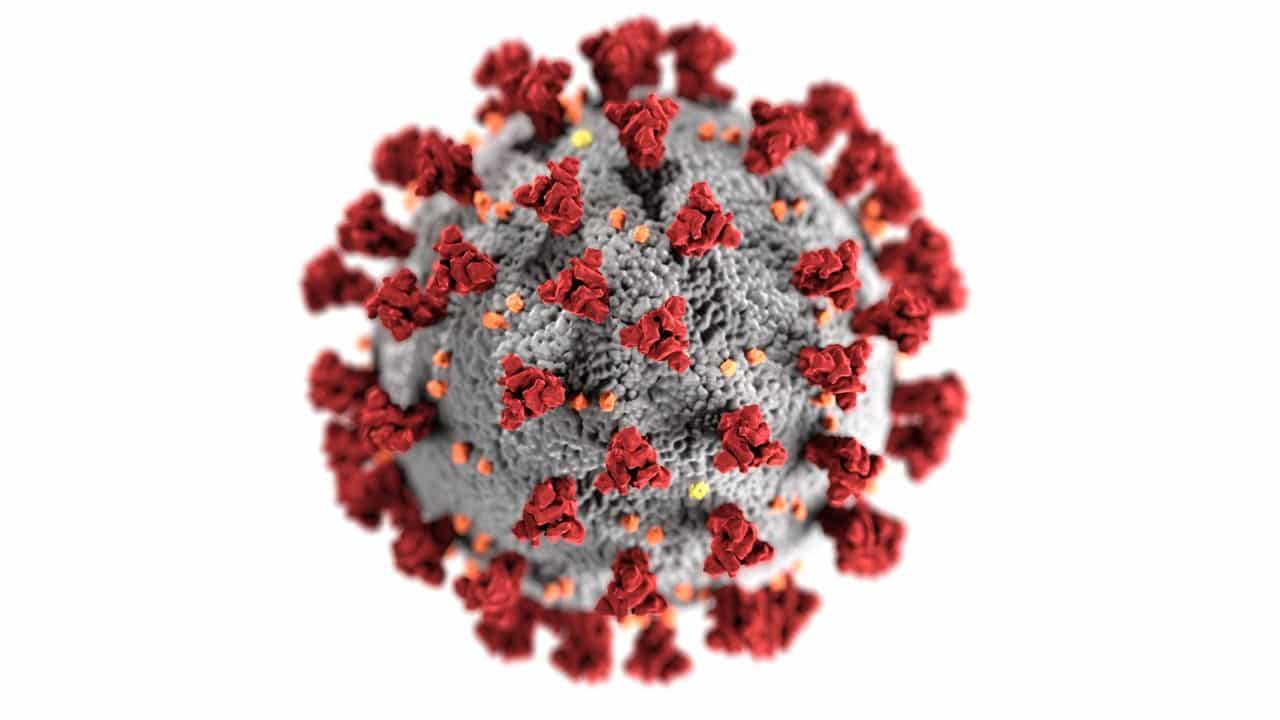Les épidémies sont de vieilles compagnes de l’Histoire humaine. Elles ont toutes été le résultat de la mondialisation, c’est-à-dire du fait que, si loin que l’on remonte dans le temps, les êtres humains se sont toujours déplacés et ils ont donc transporté avec eux d’un endroit vers l’autre les microbes auxquels ils avaient eux-mêmes survécu. On connaît le terrible impact des maladies transportées par les conquistadors sur le monde des Indiens d’Amérique. Il explique aussi comment les populations nomades de tous les continents ont pu être exterminées par les sédentaires survivants des maladies qu’ils avaient contractées.
Car on estime que les premières grandes épidémies sont le résultat de la promiscuité avec les animaux domestiqués. Dans le Nouveau Monde, les virus transportés par les Espagnols venaient de la domestication du porc et des vaches. En général, on sait que sur 2500 virus capables de tuer l’homme 1400 viennent des animaux. Naturellement ce n’est pas de leur faute. De nos jours aussi les récentes épidémies ont toutes été liées au contact avec les bêtes. Il s’agit à présent de celles qui ont été chassées de leurs habitats naturels par l’extension de la présence humaine. On apprend une nouvelle fois que cela s’est produit en Chine du fait de chauves-souris venues s’installer en ville après la destruction de leurs gites par les implantations des êtres humains. Il est donc bien normal qu’au fil des siècles les épidémies soient surtout venues d’Asie puisque c’est là que se trouve à la fois le plus grand nombre d’êtres humains et le plus grand nombre d’animaux domestiqués.
Dans le passé on avait le temps de voir venir, on avait le temps d’entendre parler de l’avancée d’une épidémie. Des quarantaines étaient donc organisées dans les ports avant le débarquement des marchandises et des hommes. Ce qui est nouveau, ce n’est donc ni les épidémies, ni la mondialisation qui les propage, mais la nature de l’impact que cet événement provoque dans la société humaine de son époque. Les virus amenés par les Espagnols ont détruit la civilisation des Indiens d’Amérique du Sud plus sûrement que n’importe quel armement ou légende qui sont censées avoir favorisés leur conquête. On avait d’abord calculé que l’hécatombe avait concerné deux ou trois millions de personnes. On pense aujourd’hui qu’il s’agit de 100 millions d’Indiens. L’impact de cet événement s’observe dans les carottes glaciaires que l’on prélève au pôle Nord et où l’on voit pour cette époque une baisse notoire du carbone que l’air transportait depuis les millions de foyers que les humains entretenaient.
De nos jours, ce qui sera remarquable c’est que les chaînes d’interdépendance dans la production, qui se seraient autrefois rompues et réparées à échelle locale, seront rompues à échelle du monde parce que l’atelier général de notre époque est en Chine. Il faudra quelques semaines pour observer concrètement cette rupture et il en faudra de nombreuses autres pour rétablir les circuits antérieurs à l’épidémie. Le sol de la production est malgré tout réuni par des canaux très divers avec celui de la bulle financière mondiale et du système des valeurs fictives qui s’y trouvent. Le nuage des dettes innombrables des États et des particuliers peut percer à tout moment par quelque créancier des plus improbables, quelque part dans cette nébuleuse de valeurs plus ou moins fictives.
Avec cela, partout l’épidémie va rencontrer des exigences sanitaires et des systèmes de santé déjà largement mis sous tension par les politiques de réduction des dépenses dans les services publics. C’est donc une terrible force de dislocation qui va agir. Partout les pouvoirs politiques en place seront rendus responsables des innombrables dysfonctionnements et aberrations qui surgiront dans la gestion de la crise. Ils seront vécus comme autant de symptômes de l’inefficacité et l’illégitimité des pouvoirs jugés incapables de les juguler à moins qu’il ne soit purement et simplement accusés de les avoir provoqués. On ne sait combien de temps durera cet épisode. On ne sait pas s’il ne rencontrera pas, par-dessus le marché, un épisode de dévastation liée au changement climatique.
Nos sociétés sont donc promises à une rude mise à l’épreuve de la validité de leurs principes d’organisation, de la hiérarchie de leurs normes et des cultures collectives qui les animent. Dès lors, tout est possible : le meilleur comme le pire. Solidarités impérieuses ou violences du « chacun pour soi ». La logique de ce que nous observons dans le monde depuis que déferlent partout des révolutions citoyennes donne une idée du meilleur. C’est cette volonté d’auto-organisation et d’auto-contrôle dont sont saisies des masses humaines immenses. Elles ont résisté contre tous les types de pouvoirs et à toute la violence que ceux-ci sont capables de déchaîner contre les gens. Cet épisode pourrait venir à nous en France où se conjuguent le discrédit profond du pouvoir et des institutions politiques avec une mobilisation sociale motivée et argumentée comme celle qui vient de se dérouler à propos du droit à la retraite. Je ne me risquerais pas aujourd’hui à prévoir quoi que ce soit à ce sujet. Mais la pente est prise et je ne vois pas pourquoi elle s’inverserait.
Je ne peux finir ce petit coup d’œil sans une pensée tirée d’un peu d’Histoire. En 1720, le bateau « le grand Saint-Antoine » voulut accoster à Marseille. Après diverses péripéties manigancées par le capitaine, le maire de Marseille et des agents de sécurité sanitaire corrompus, le bateau put décharger ses passagers mais surtout ses marchandises alors même que plusieurs passagers étaient déjà morts du choléra à son bord. L’épidémie tua jusqu’à 60 % de la population marseillaise et s’étendit à toute la Provence. C’est à cet épisode que se réfère Le Hussard sur le toit de Jean Giono.
Son roman confronte un personnage central à la fréquentation de gens qui peuvent mourir à tout instant et ne s’en privent pas, dans une société totalement désorganisée. À lire ou à relire absolument. Non pour se faire peur mais pour méditer ce que veut dire vivre en compagnie de la mort et de la peur que répand une épidémie. Naturellement nous n’en sommes pas là. Mais le thème vaut d’être pensé pour regarder la peur dans les yeux avec le pouvoir d’en rire joyeusement. Peut-être est-ce la seule façon par là même de vaincre l’une et l’autre en les dominant par l’esprit. Le risque de la mort subite et imprévue fonctionne comme une allégorie de ce qu’est au fond une vie humaine. On mourra tous, un jour ou l’autre, tout soudain ou dans longtemps, très jeune ou très vieux et sans l’avoir choisi. Alors la mort, probable mais incertaine, fonctionne comme un écrin qui souligne la beauté de l’instant et fortifie le goût de le vivre. Aussitôt la dignité de l’être humain est rétablie. Sachant que tout peut s’interrompre à tout instant, on se réapproprie alors son existence d’une façon qui répond à ce défi en le dissolvant dans un carpe diem sans limite. La vie triomphe de la mort. Et l’esprit du virus qui pourtant le terrasse.