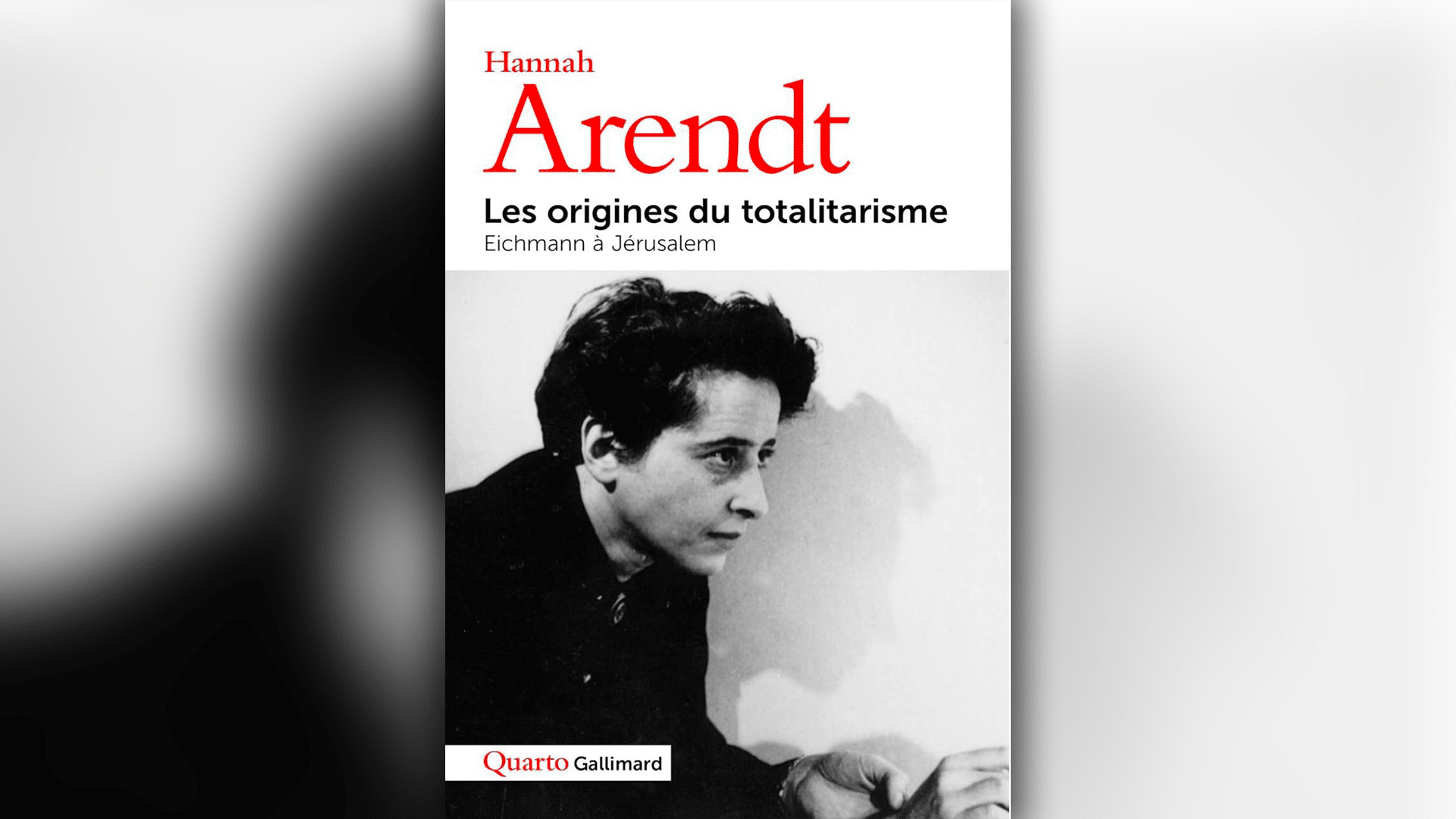Version relue et précisée
À propos du procès d’Adolf Eichmann auquel je me suis référé à Lille dans le rassemblement contre la censure de nos conférences, une réaction médiatique m’a fait croire une fois de plus à l’inculture de cette partie de la classe médiatique shootée au buzz. Mais j’aurais dû deviner l’action plus banale des réseaux de connivences. Cela n’a plus aucune importance à mes yeux. L’effondrement de la parole médiatique en France est un fait assez avéré dans l’opinion française et dans la presse internationale pour qu’il y ait besoin d’y rajouter. Mais puisque le sujet a été mis sur la table médiatique de façon aussi grossièrement conflictuelle, c’est une occasion à saisir dans la tradition de l’éducation populaire. Question : Eichmann, intendant du génocide des juifs par les nazis. Mais de quoi est-il aussi le nom depuis son procès à Jerusalem en 1951?
Car, au-delà de sa responsabilité dans l’organisation concrète de la Shoah, son attitude et son système de défense au cours de son procès à Jérusalem donnèrent une portée nouvelle au crime dont il était coupable. Ce fut l’objet du travail de la philosophe Hannah Arendt qui suivit et décrypta le procès (« Eichmann à Jérusalem »). Cet épisode de son travail se retrouve dans ses autres recherches comme celui sur « l’origine des totalitarismes ». Elles constituent une contribution extrêmement importante à la construction de la pensée du vingtième siècle pour comprendre le terrible défi à la raison et à l’humanité que lançait la tentative de génocide des juifs planifiée par les nazis.
Ce qui frappe dans ce procès éclate au regard (en tous cas au mien) quand Eichmann est appelé à répondre au juge au moment où celui-ci lui présente les motifs de l’inculpation et lui demande s’il plaide coupable ou non. Eichmann répond alors qu’il n’est pas coupable « au sens de l’accusation », qui lui imputait une responsabilité personnelle dans le crime qu’il avait organisé matériellement. Pour lui, il n’avait fait qu’obéir aux lois en vigueur dans son pays au moment des faits. C’étaient les lois antisémites des nazies. Sa responsabilité est donc entière dans la bonne exécution du plan dont il avait la charge, mais il ne se sentait aucune responsabilité dans le résultat criminel de cette action, puisque, selon la loi, ce n’en était pas un.
Les thèses d’Arendt ont certes donné lieu à de nombreuses discussions et critiques. Mais j’ai été impressionné, à l’époque où j’ai découvert l’auteure, par la façon avec laquelle elle avait disséqué les mécanismes qui permettent la mise en œuvre d’actions abominables par des gens qui se sentent totalement exempts de toute responsabilité morale dans le résultat de ce qu’ils font. La tâche meurtrière est décomposée en segments d’exécution banale. Personne n’endosse la finalité de l’action, mais seulement la bonne exécution d’une partie technique du tout.
Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, nous lisions et discutions entre jeunes dirigeants politiques des textes contradictoires sur le sujet de la responsabilité morale et sur ses assises. Au fil du temps j’ai entendu hésiter entre « Leur morale et la nôtre » de Léon Trotsky (auquel je n’adhérais pas sur ce sujet), « Les militants et leur morale » de Colette Audry (qui fut mon guide) et les textes de Arendt.
Bien plus tard, à cinquante ans, le souvenir de ces discussions de jeunesse m’a encore inspiré. Je devais écrire mon discours prononcé au nom du gouvernement Jospin en avril 2001, lors de la commémoration de la rafle du Vel’ d’Hiv’. J’étais prêt. J’avais trouvé dans l’analyse de Arendt la description d’une double dissolution du sens moral des évènements auxquels participent les agents d’exécution des régimes totalitaires.
D’abord, dissolution du sens de la responsabilité individuelle dans la portée de ce qui s’accomplit. Je viens d’en parler. Mais j’en ai pour ma part une interprétation élargie. J’incrimine certes ceux qui agissent de cette façon aveuglée. Tous, sans exceptions ni excuses. Mais aussi ceux qui, étant informés du crime, ne réagissent pas et ne font rien pour l’empêcher. Et cela même s’ils n’en sont pas directement partie prenante ni de près ni de loin géographiquement. Pour moi ceux qui savent ce qui se passe à Gaza (et comment pourraient-ils l’ignorer) et ne font rien pour empêcher le crime sont de fait complices et donc coupables sur le plan moral, et pas seulement ceux qui accomplissent le crime. Dans un sens positif, ici doit être mise en jeu une aptitude permanente à une forme de compassion radicalement responsable. Pour ma part j’avais décrit dans une tribune de presse l’engagement anti capitaliste comme une forme « d’insurrection morale permanente ». Mais à l’époque où ces questions se posèrent à moi, j’en trouvais l’expression positive dans une consigne attribuée au Che Guevara quand il déclarait : « surtout, soyez toujours capables de ressentir au plus profond de votre cœur n’importe quelle injustice commise où que ce soit dans le monde ».
La seconde dilution du sens que je vois agir, dans la perte du sens moral des actes auxquels prennent part ce genre de criminels intervient au moment où ils confondent ce qui est légal et ce qui est légitime. Les actes que posent les complices et les bourreaux totalitaires sont le plus souvent « légaux » au moment où ils ont lieu, même s’il s’agit de « lois d’exception » ou autres dispositions soi-disant liées à des circonstances particulières. Mais sont-ils légitimes ? C’est-à-dire : ne viennent-ils pas en contradiction avec des principes plus élevés, dont le respect éviterait de commettre un crime ?
J’ai connu un camarade, alors militaire argentin sous la dictature du général Videla. Son prénom c’est Gustavo. Il participa d’abord de bon cœur, comme conscrit, à la capture et la répression de ceux que les chefs désignaient comme des « terroristes » dangereux. Il ne le fit pas longtemps. Quand il vit comment se déroulaient les arrestations, les violences, les vols qui les accompagnaient, il entra en dissidence. Et il ignorait alors les tortures et les meurtres par lesquels s’achevaient ces arrestations. Il fut lui-même aussitôt arrêté et torturé.
Il ne dut la vie sauve qu’à des implications militantes. Amnesty International faisait campagne pour réclamer l’adoption par des Français pour ces Argentins arrêtés et emprisonnés dont les noms nous étaient connus (tous ne l’étaient pas, et les fascistes en profitaient pour les assassiner alors sans retenue). Au cas précis, ce furent Yves Montand et Simone Signoret qui signèrent à Paris cette « adoption » de Gustavo. Ils se sentaient, comme nombre d’autres, impliqués par ce qui se passait pourtant si loin et si opaquement. La résistance à la dictature qui tua trente mille personnes ne leur paraissait pas être du terrorisme.
Du refus de participer à des actions légales mais criminelles, jusqu’à l’implication de deux artistes pour adopter des personnes accusées de terrorisme, il y a un continuum d’inspiration morale. Il consistait à poser des actes qui introduisent une autre légitimité que l’exécution servile et irresponsable et le laissez-faire qui allaient avec. Les discussions sur ce sujet nous tenaient en éveil, quelle que soient les conclusions que chacun en tirait.
J’ai reconnu dans ce que j’ai vécu à Lille un écho de ces moments. Et c’est pourquoi j’ai fait référence à Eichmann, en expliquant les mécanismes que la servilité et la couardise mettaient en œuvre quand sans autre motif qu’une invocation légale abstraite (le « trouble de l’ordre public » provoqués par nos opposants) un président d’université attente à une liberté dont il a la garde. Cela était parfaitement clair si on écoute toute la séquence de mon discours à ce sujet. Ici, il y a un continuum de la banalisation du mal entre celui qui cède aux pressions et sacrifie la liberté qu’il a pourtant la charge de garantir, et celui qui en fait un récit truqué pour défigurer le message en insultant le messager.
Cette banalité de la mise en œuvre du mal est faite d’une longue chaîne de mensonges. Le président de l’université, dont j’ai dit qu’il était sûrement un brave homme au plan personnel, ne croit pas un instant que des propos antisémites allaient être tenus. Trop de mes discours et de ceux de Rima sur ce sujet en témoignaient. Le préfet non plus, qui prétextait la sécurité de la salle, mais écrivit un arrêté d’interdiction sur d’autres motifs. Le « journaliste » qui lance le sujet encore moins, quand il répète les éléments de langage de son engagement politique personnel. Ni le dénonciateur, qui fait semblant de s’interroger sur un logo qui « effacerait Israël ». Tous se mentent, et mentent aux autres, pour mettre en œuvre un abus de pouvoir. C’est-à-dire pour le justifier, en désamorcer le sens immoral. Et surtout dissoudre l’objet central du litige : un génocide.
Ici la banalité du mal est dans leur irresponsabilité morale additionnée. La vertu est dans la résistance à la peur qu’ils veulent inspirer, à l’isolement qu’ils veulent provoquer. « Le courage isole d’abord », dit Rima Hassan. Et ceux-ci y comptent bien. Mais on a vu le rassemblement le jour même sur une place en trois heures. Ou celui qui se fit à Marseille autour de Rima Hassan deux heures après qu’elle ait appris sa convocation absurde pour « apologie du terrorisme ». Cela montre comment a grandement progressé dans notre peuple une éducation de masse, capable de reconnaître le mufle du mal, et de poser l’implication personnelle pour y résister.
Rima Hassan avait encore bien raison à Lille : « La censure est l’arme de ceux qui ont déjà perdu ».