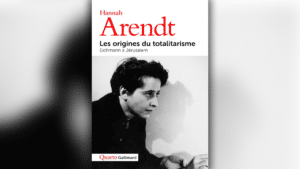Un mot qui en dit long
Avez-vous remarqué ? Dorénavant on dit « l’insoumis untel, la députée insoumise une telle ». Des gens se présentent à moi « je suis Untel, insoumis du Var ou de Châteauroux ». Bref, on dit, et on se dit « insoumis » comme on se dit républicain au sens large. L’adjectif est devenu une caractérisation politique, sans crier gare. On pourrait trouver cela tout bien normal après une élection où le mot a bien vécu sa vie au côté d’un candidat qui en avait fait son drapeau. Mais je vois une différence qui saute aux yeux. Seul le terme « insoumis » décrit à la fois un engagement politique et une manière d’être personnelle. Et, c’est vrai : l’insoumis fait un choix politique en prolongement d’une façon personnelle d’aborder la vie. Ce n’est pas un fait politique ordinaire qu’un tel enracinement intime de l’engagement.
Je range cette situation dans la liste des acquis de notre action. Exactement comme lorsque j’entendais les gens applaudir au moment où je disais : « nous sommes réunis par un programme davantage que par la personne de son candidat ». À présent, en devenant un nom commun, le mot « insoumis » introduit dans son usage toute la profondeur de sa signification. Qu’est-ce qu’un insoumis ? Un être qui refuse toute sujétion. Qu’est-ce qu’une personne assujettie ? Quelqu’un placé sous une domination imposée. S’en affranchir c’est s’émanciper.
Voyez comment, en peu de lignes, pour le simple usage d’une définition, sont convoqués des mots fondamentaux dont le sens est situé au croisement des comportements individuels et de notre programme politique ! Sujet ou partie prenante ? Domination ou émancipation ? Autrement dit aussi : sujet ou citoyen, dominé ou indépendant. Ces enjeux sont de tous les âges. La révolte de Spartacus nous parle encore.
Oui, l’insoumission individuelle est le premier acte d’une lutte émancipatrice collective. Elle en est le ressort individuel le plus intimement ancré. Sa portée est si ample ! Car qu’est-ce que l’émancipation ? L’histoire des mots nous l’apprend aussi bien qu’un long discours. Le mot vient du latin « ex mancipium ». Sortir du mancipium. Le mancipium, c’était le pouvoir absolu accordé au père de famille sur sa femme et ses enfants. À cette époque, « l’émancipé » c’est la personne parvenue à l’âge où elle n’est plus assujettie à ce pouvoir. Comme l’esclave une fois affranchi, elle devient alors son propre maitre.
C’est ce que vise l’insoumis. Dans tous les domaines. Cela concerne aussi bien la vie de la cité, celle de son corps, celle de son esprit. Cela concerne les libertés publiques, le droit à disposer de soi face à l’enfantement ou face à la mort, le droit de chercher à penser librement contre les préjugés et les idées dominantes. Et le droit de l’exprimer.
La règle et l’insoumission
Pour des observateurs nonchalants, l’insoumis, femme ou homme, est une personne tentée par le refus de toute règle, en désaccord avec tout ordre social et avec toutes normes. L’insoumission est à leurs yeux dangereuse parce qu’elle est à la fois incontrôlable et surtout jamais satisfaite. Le décryptage des motivations de tels donneurs de leçons suggère bien des moqueries, non ? Mais j’y renonce. Je préfère aller tout droit au démenti.
Refuser une règle, une norme une loi ce n’est certainement pas refuser toute règle en général, ni toute loi ou toute norme. D’une certaine façon, c’est tout le contraire. On nous aura pris pour d’autres. Les libéraux, eux, pensent que la liberté naît dans le retrait des règles. Pour eux la liberté se constate quand les mécanismes spontanés qui animent la réalité ne sont plus déformés ou empêchés par des interférences extérieures. La main invisible du marché ne doit-elle pas être totalement libre de ses mouvements ? De fil en aiguille, cette vision du monde accorde à notre égoïsme individuel le rôle de bienfaiteur de l’humanité. Et à la fin, l’intérêt général est censé être la somme des intérêts particuliers. Et cela qu’il s’agisse de nos pulsions ou de la circulation des marchandises. À nos yeux, cette liberté ouvre directement la porte à la loi du plus fort. C’est le fameux renard libre dans le poulailler libre. Pour notre part, nous croyons au contraire que la liberté n’existe pas en dehors des règles qui organisent son exercice et la rendent donc possible. C’est pourquoi nous sommes si vigilants sur l’origine des règles et sur leur contenu.
Pour nous donc, la liberté pour évaluer la règle nous est chère entre toutes. Elle est la base de notre consentement à la norme. Le message de l’insoumission fonctionne comme une sorte d’adage : « Comment pourrais-je accepter ce que je n’aurai pas le droit de contredire ? »
L’insoumis n’est donc nullement un nihiliste. Il ne refuse pas toute règle tout le temps. Il sait que la règle est la façon de rendre concrète une liberté. Il est donc prêt à participer à son élaboration, à composer, et même à laisser s’exercer une règle si c’est la loi, quand bien même il la désapprouve. Mais il y met deux conditions. D’abord que la décision soit prise collectivement après délibération contradictoire et non du fait d’un seul. Ensuite que la liberté de contester une décision ne soit jamais éteinte.
L’extension du champ de l’insoumission
Dans l’ordre politique c’est ce qui se passe quand on vote. Le vote est ouvert à tous. Il est précédé d’un débat contradictoire. Certes, le mode de décision est arbitraire puisqu’on décrète que 51 ont le dernier mot sur les 49 autres. Mais le vote ne produit que la décision à prendre. Il n’oblige pas à changer de conviction. On accepte le résultat du vote, mais personne ne peut nous obliger à changer de point de vue. À partir de là, notre droit à contester le contenu de la décision prise doit rester intact. Et cela quand bien même la décision s’applique quand même parce que c’est la loi votée par la majorité.
Dans la vie de l’esprit c’est encore plus simple. À tout moment nous pouvons remettre en cause nos décisions parce que nous avons appris quelque chose qui modifie notre regard ou parce que nous avons fait une expérience qui a contredit nos certitudes. Sans exagérer, on peut dire que l’insoumission est le fil conducteur du processus qui fait de vous une personne unique. Et ça commence tôt. Pour pouvoir devenir une personne, l’enfançon doit assimiler des règles de comportements qu’il ne lui est pas permis de contredire ou d’ignorer. Elles vont lui permettre de prendre place dans le monde qui lui préexiste. Jusqu’au point où en commençant à dire « non », souvent à tous propos, la jeune personne commence à exister en tant que sujet de la relation avec les autres. La sortie du « mancipium » est une histoire intime autant que politique. Mais tout commence par l’insoumission.
L’insoumission n’est pas seulement un fait politique ou social. C’est aussi un acte de la pensée quand elle cherche à devenir souveraine. Car les forces qui jugulent ma liberté peuvent être bien plus insidieuses que la matraque du tyran. C’est-à-dire qu’elles peuvent parvenir à faire oublier qu’elles sont imposées, elles aussi, de l’extérieur et qu’elles œuvrent en moi sans mon approbation formelle. J’y consens seulement parce que cela me parait évident sans que j’y ai réfléchi, sans en avoir évalué le bien fondé. Telle est la force des préjugés, des dressages sociaux, des idées et des goûts dominants.
Dès lors, l’état d’insoumission n’interpelle pas seulement l’ordre social ou politique mais aussi le système des idées dominantes qui justifie son pouvoir. C’est peut-être l’essentiel. Car on voit bien comme une autorité politique illégitime gouverne d’autant plus facilement si elle a pu me faire admettre qu’elle est au service de ce que je crois juste. L’insoumis sait que le dominateur avance toujours masqué. Au plan intellectuel, l’insoumission s’oppose à la domination sur soi des idées auxquelles elle n’a pas consenti librement. Pas besoin de faire un dessin pour présenter le lien qui unit l’insoumission intellectuelle et politique. Mieux qu’un discours à ce sujet, voici une preuve majeure : nous-même, les insoumis. Nous, « en troupe en ligue en procession et puis tout seuls à l’occasion » comme chantait Ferrat.
L’insoumission et la liberté de conscience
De ce petit remuement d’idées, on peut conclure un autre point très important. Rejeter les règles illégitimes et mettre en quarantaine les préjugés, c’est faire vraiment un rude ménage. Que reste-t-il après ça ? Tout, parce qu’on ne peut pas se vider la tête, rien parce que tout est suspect ! Et pourtant il faut vivre. Et donc décider en permanence. Et de toute façon nous le faisons. Ici entre en scène une aptitude essentielle, notre bien le plus précieux : la liberté de conscience. Elle nous permet de choisir nos outils pour faire le tri entre les possibles.
La liberté de conscience est première. C’est elle le poste de pilotage d’où tout s’évalue : qu’il s’agisse de ce qui est bon pour soi comme de ce qui est bon pour tous. Au demeurant la liberté de conscience est la seule liberté à qui on ne peut imposer aucune limite. Même recluse sous les monceaux de dressages, même abrutie par les prêches médiatiques, la petite lumière est pourtant rallumée à chaque seconde. Cela parce qu’il faut vivre et que cela veut dire choisir, du matin au soir, à propos de chaque geste. La liberté de penser est la condition de notre survie quotidienne. Et quand l’esprit aborde le domaine des idées, ou celui des règles à respecter pour agir chez soi ou dans la cité, il en va de même. L’insoumission est directement liée à l’instinct de survie. Pour prendre la bonne décision quelle qu’elle soit, je dois commencer par réfléchir et mettre en balance les possibles. Bien sûr, dans les situations déjà vécues, heureusement que la mémoire des bons gestes est là ! Mais devant chaque nouveauté, face à tous les paradoxes que la vie courante oppose à notre premier mouvement, il faut réfléchir. Pour prendre la bonne décision, il faut anticiper les conséquences. Se projeter c’est déjà se détacher de l’instant, du lieu de la circonstance particulière. C’est-à-dire ne pas se soumettre à la dictature de l’impulsion incontrôlée. L’arbre de la vie et celui de la connaissance ont partie liée. Rien ne peut empêcher de penser, c’est-à-dire d’évaluer le sens de nos actes. Et même sous la contrainte, la pensée peut rester libre. « Et pourtant elle tourne » soupire Galilée, muselé mais insoumis.
Un mot qui vient de loin
Dès lors, la racine de ce que nous sommes, nous les « insoumis », plonge bien plus profond que ne le signale l’apparition si récente de la formule « la France insoumise » dans ma campagne présidentielle. J’espère l’avoir montré en faisant ce tour d’horizon des définitions et de quelques champs d’applications de l’idée d’insoumission. Beaucoup s’en doutaient. Ils le savaient d’instinct. Mais je dois encore montrer autre chose : comment le mouvement si intimement ancré en nous a déchiré les voiles obscurs qui masquaient l’oppression autrefois. Car tout n’a pas commencé avec nous. Je me fais donc un devoir de montrer comment elle est notre fil rouge courant dans le fouillis des évènements aussi loin qu’on aille dans le temps. À chacun ensuite de le repérer et de le prolonger dans son domaine. Telle est la mission de ces millions de personnes qui dorénavant assument d’être des insoumis politiques.
J’ai commencé à nommer ce dont il est question quand j’ai parlé de cet « humanisme écologique et social » qui serait notre philosophie commune. Pour faire court, j’ai parlé de « nouvel humanisme ». D’une façon générale je crois que ces mots ont été acceptés parce qu’ils semblaient aller de soi pour qui proclame « l’humain d’abord ». Peut-être parce qu’ils résument l’idée de l’attachement à l’épanouissement de la personne humaine dans une société capitaliste qui tient si peu compte des besoins matériels et culturels les plus élémentaires des êtres humains.
Je vais rester sur cette formule. J’aime sa simplicité. J’aime le plan d’explication qu’elle suggère aussitôt par les deux questions qu’elle appelle. La première : qu’est-ce que l’humanisme ? Le deuxième : en quoi notre humanisme est-il nouveau ?
Du fond du temps
En proposant de nous penser comme un nouvel âge de l’humanisme mon intention est de placer le moment présent de la pensée insoumise dans l’histoire des idées. Je veux l’inscrire dans le contexte étendu des siècles qui l’ont amenée jusqu’à nous. Car la pensée critique du mouvement ouvrier « socialiste » n’a pas non plus surgi par elle-même à partir de rien. Elle a prolongé des siècles de réflexion sur la vie des êtres humains en société, le sens de l’existence individuelle, la légitimité du pouvoir et celle des règles qui s’appliquent à tous. Sa contribution particulière aura été de montrer comment l’injustice et l’inégalité ont leurs causes dans les rapports sociaux de production et d’échange. Mais pour que cela lui fut possible, il lui avait aussi fallu hériter d’une tradition philosophique et politique qui lui fournisse le goût de la pensée critique et les matériaux de base pour l’engager.
Dans l’histoire récente, c’est-à-dire depuis trois ou quatre siècles, la possibilité de penser « autrement » a été le plus souvent l’enjeu de luttes dont la portée excédait de loin l’objet du litige. Quand la « Renaissance » intervient à partir du 15e siècle en Italie dans les lettres et la pensée européennes, la revendication d’une pensée distincte des injonctions du discours religieux et de l’ordre social qu’il soutient est vite un acte de combat politique. Le retour des textes de l’antiquité grecque et romaine avait été déflagrateur. Les certitudes pétrifiées de l’univers politico-culturel chrétien avaient déjà été sévèrement ébranlées par le contact dans les croisades avec les savoirs conservés par les musulmans affrontés. Ce fut d’abord un retour aux sources. La reprise d’un cheminement intellectuel stoppé par l’étouffement dogmatique religieux. Ainsi la Renaissance a-t-elle été le début de la fin intellectuelle de l’idée de l’être humain par essence pécheur et flétri. Sa plus décisive contribution aura été de recentraliser la personne humaine et l’épanouissement de ses aptitudes comme finalité de l’organisation sociale. Il fallait en montrer à la fois la nécessité et les moyens.
C’est pourquoi les premiers pas de l’humanisme en tant que vision du monde sont ceux d’une lutte pour le droit de penser en dehors du cadre religieux. Si bien qu’elle est devenue, comme c’était prévisible, une pensée contre ce cadre religieux ! En cela, d’entrée de jeu, il fut subversif, c’est-à-dire dangereux pour l’univers mental qu’il pulvérisait et surtout pour les institutions dont il prouvait l’illégitimité. Il fut donc très cruellement réprimé. Mais la rupture fondatrice du nouveau point de vue n’a pas pu être éradiquée. Sa dynamique ne s’est jamais épuisée. Car elle dispose de toute la force propulsive d’un point central : les êtres humains sont seuls producteurs de leur réalité. Une idée qui reste radicalement neuve.
Elle retentit dès qu’elle fut énoncée. Par exemple avec le livre de Pic de La Mirandole, De la dignité de l’homme (1487). Il fait figure de manifeste parmi les textes fondateurs de cette période de l’histoire des idées. Les êtres humains, dit-il, se distinguent de toutes les autres « créatures » en ceci qu’ils définissent eux-mêmes ce qu’ils sont et ce qu’ils doivent faire à partir de là. L’humain peut ou régresser ou bien progresser selon la sculpture qu’il fera de lui-même d’après les conclusions de ses raisonnements. Cette thèse enracine la liberté de pensée consubstantielle à l’existence humaine. Ce n’est donc pas une option idéologique. C’est une nécessité. Et du coup c’est le point de vue contraire, celui du dogme, qui devient « idéologique », c’est-à-dire relatif alors qu’il se prétendait absolu.
L’humanisme, en commençant le parcours pour l’émancipation intellectuelle, ne pouvait manquer de conclure sur la nécessité de l’émancipation politique. Peut-il en être autrement tant que le pouvoir politique prétendait tirer sa légitimité d’un ordre divin, par nature indémontrable ? De l’humanisme philosophique surgit ainsi bien vite un « humanisme civique ». Celui-ci a étendu à l’organisation de la cité le devoir de libre délibération à propos de la légitimité de ses institutions. Les premiers textes des libertins français du 16e siècle concluent vite : « tout pouvoir politique qui se réclame de Dieu est une imposture ». Avant eux, le quattrocento italien était déjà parvenu à des conclusions républicaines certes diverses mais bien affirmées. Le concept d’« humanisme civique » qui regroupe ce moment de la pensée est sans doute discuté depuis son invention mais il a le mérite de faire connaître une rupture dans l’ordre de la pensée politique comme suite à un basculement philosophique.
Ce basculement commence par l’insoumission intellectuelle. Pour elle, toute norme est suspecte aussi longtemps que son bien-fondé n’est pas démontré. Le doute méthodique comme méthode de penser vient de loin lui aussi. Elle surgit parfois où on ne l’attend pas. Une polémique à propos de ce qu’est le « bon usage » de la langue française au début du 17e siècle l’illustre. La Mothe Levayer montre qu’on ne peut dire comment on doit parler correctement sans tenir compte de ceux qui édictent cette norme. Car elle n’est pas socialement neutre. Peut-on penser librement si la norme de l’usage de la langue est fixée sur des considération qui excluent des locuteurs ? Et si tel est le cas alors peut-on dire que l’on est en état de penser librement ? Bref, en toutes circonstance l’être humain raisonnant est le siège d’où part le chemin vers la vérité. Celle-ci ne vient plus ni de Dieu ni de la direction de conscience d’une cléricature. Mais l’exercice de cette liberté de conscience ne peut jamais être dissociée des conditions sociales dans lesquelles elle s’exerce.
L’Humain dans sa nature ?
Du coup, la centralité de l’être humain exige donc d’abord qu’il dispose d’une pensée capable d’être libre. Cette libération est un art bien délicat. Il dispose de son outil : la raison et son mode d’emploi. L’idée mettra du temps à s’énoncer clairement et dans toutes ses conséquences avant Descartes. Cet apurement des idées a eu des conséquences dont ses auteurs n’envisageaient pas la portée. Car il en est résulté une sorte de guerre évidente contre tout ce qui viendrait de l’intérieur de celui qui pense et pourrait perturber la liberté de sa délibération. On a tôt fait d’y ranger les passions et les pulsions. Elles sont si promptes à se rendre maître de nous ! Et elles s’imposent à nous si souvent contre les recommandations que nous fait la raison. Ici, d’une certaine façon, l’ascèse intellectuelle rationaliste prendrait facilement le relai des mortifications religieuses traditionnelles. Encore une fois, l’esprit devrait dominer le corps, c’est-à-dire s’en tenir à distance, pour que l’inverse ne se produise pas. En poussant à combattre tout ce qui dans l’être humain le rattache aux déterminismes qui le lient à la nature, le pas est vite franchi qui consiste à voir dans cette nature la source de tous les dérèglements.
Un chemin bien clair est tracé. Mais il est exclusif. Par la science et l’expérience, qui refusent a priori le dogme, on connaîtra la vérité ultime, celles des lois qui organisent la vie de la nature. Et donc on maîtrisera celle-ci. Dominer et maîtriser la nature est, dans ce premier temps de l’humanisme historique, inséparable de l’idée d’émancipation. L’immense Descartes, résume : l’homme qui cherche et trouve par lui-même, sans recours à une vérité révélée ni à celle des usages coutumiers, pourra « se rendre comme maître et possesseur de la nature ».
Les sciences et l’expérimentation jouent donc un rôle considérable. L’élucidation des causes et l’observation méticuleuse des effets produisent une émancipation que personne ne peut nier. Bayle, visant l’action divine sur le cours des faits, énonce : « il n’y a rien de plus ridicule que de disserter sur les conséquences d’une cause qui n’existe pas ». Mais elle est toujours et systématiquement pensée aussi comme une domination sur la nature. Au mieux celle-ci est-elle chargée passivement de fournir à la pensée les ingrédients de sa survie matérielle et de ses objets de réflexion. La nature apparait comme un cadre, un moyen, un objet de savoir à conquérir.
La nature existe-t-elle ?
Bien sûr, cette description force le trait. L’humanisme naissant, comme celui des Lumières triomphantes, ne méconnaît pas si radicalement l’implication déterminante de l’être humain à la nature et d’abord à lui-même, c’est-à-dire à son corps. Spinoza ne proclame-t-il pas : « la pensée sera toujours davantage que le corps pensant, mais jamais moins ». Au demeurant, la source philosophique de cette nouvelle façon de penser ne le permettrait pas. C’est par le contact avec les textes du matérialisme antique que se fait la renaissance intellectuelle. Certes, Epicure, Epictète, Démocrite et combien d’autres ont ouvert le chemin et le voyage a repris à partir de leurs acquis. Mais cela ne suffit pas.
Car en toute hypothèse, la question de la nature n’a pas eu la centralité qu’elle s’est donnée à notre époque. Sans doute aussi nos pères fondateurs redoutaient-ils trop de voir la nature devenir la nouvelle instance de normes et de vérités transcendantes. Admettons que le risque n’est pas si exagéré. Les élans mystiques contemporains sur la « pacha mamma », « la terre mère », etc. en attestent. Et je le dis là encore avec des réserves pour signifier que je sais faire la part entre l’élucubration folklorique et la version plus élaborée de la « pacha mama » en tant que globalité de l’espace-temps. Mais admettons que « la nature » impose ses « lois » sans aucune discussion… Faut-il dès lors admettre que les libres microbes envahissent nos organismes conformément à leurs objectifs de survie dans l’équilibre général de la biosphère ?
Quoiqu’il en soit, la question de la relation de l’homme à la nature est l’impensé ou le mal pensé de l’Humanisme historique. On ne peut le lui imputer davantage qu’à une autre branche des courants politiques de l’émancipation. Le 20e siècle a bien propagé son hégémonie productiviste. Je sais bien aussi à quel point cette assertion peut être contredite par les innombrables incises de Karl Marx lui-même sur la nature comme « corps inorganique de l’homme » et sur la capacité du capitalisme à « épuiser l’homme et la nature ». Mais personne n’a réclamé cette part de l’héritage parmi ceux qui se sont ensuite réclamés de lui. C’est ce que prouve le lien intime entre la stratégie social-démocrate et la dynamique productiviste du capitalisme. Puis celui du communisme d’État avec le culte aveuglé du développement des forces productives.
Tout cela montre à quelle limite interne la prise de conscience écologiste s’est encore heurtée à des âges récents. On doit conclure que c’est au déchainement productiviste du capitalisme, à son incapacité intrinsèque à assumer un quelconque intérêt général humain, que l’on doit d’avoir vu la question devenir incontournable. C’est parce que tout l’écosystème compatible avec la vie humaine est menacé de destruction que la pensée sur cette menace a pu naitre. Elle nous oblige à revisiter toutes nos constructions intellectuelles. Et à mettre à l’épreuve nos héritages doctrinaux.
Le fil rouge
Le fil rouge qui part des philosophes matérialistes de l’antiquité, passe par « l’humanisme civique » du 16e siècle, se prolonge dans l’idéal émancipateur du socialisme historique. Il est de nouveau convoqué pour aider à penser les défis de notre temps. L’humanisme est antérieur à la gauche qui est un épisode de son histoire. Il est innocent des crimes du stalinisme et de la social-démocratie. Il englobe toutes les traditions émancipatrices là où les autres en excluent tout ou partie. Mais une nouvelle fois, il doit se reformuler dans sa perception des impasses intellectuelles de la civilisation humaine et dans ses conclusions politiques.
La foi aveugle dans la prétendue « loi du marché », la négation de la crise catastrophique de l’écosystème humain, le refus de voir le lien entre les deux, tout cela fonctionne comme un obscurantisme dogmatique, violent et désastreux. Le caractère globalitaire d’un système de production, d’échanges et de consommation qui formate les goûts autant que les comportements individuels suscite une insoumission ardente en même temps qu’un écœurant suivisme de masse. Dans cet ordre des choses, la marchandise et sa consommation sont au centre de la vie en société. L’accumulation égoïste de la richesse, sans limite, est son horizon ultime. Le capitalisme et la culture dominante de notre époque sont un anti-humanisme.
Mais, de son côté, l’Humanisme ne saurait connaître la renaissance dont a besoin notre temps sans reformuler son rapport au « corps inorganique de l’homme » qu’est la nature. Car le choix de la centralité de l’être humain et de son accomplissement comme objet de la vie en société n’est pas abrogé par la prise de conscience écologiste. C’est même le contraire. Car « la nature » avec laquelle il s’agit de créer un lien nouveau par rapport à l’âge productiviste ne se présente pas comme une totalité immuable par essence. La « nature » ne cessera jamais, quand bien même l’espèce humaine aurait-elle entièrement saccagé son écosystème. Rien d’autre qu’un écosystème particulier ne prendra fin. La planète peut en produire bien d’autres sur les bases mêmes de la destruction de celui-ci. La suite n’en sera pas moins « la nature » pour les milliers d’années de vie qui restent au soleil pour brûler dans l’espace infini.
C’est donc en partant de l’intérêt général humain que l’on aborde utilement et rationnellement le problème de la relation humaine à la nature. Ce qui est en cause change alors. Il ne s’agit pas d’assumer une « loi de la nature », mais de concilier l’activité humaine avec la pérennité de son écosystème. L’évolution chaque année de la date d’entrée en dette écologique de la civilisation humaine pose le problème dans toute son effrayante réalité. C’est moins mystique mais c’est plus concret. Toute l’affaire, éclairée par l’expérience, peut se résumer en quelques mots : contrôler la prédation humaine sur les ressources naturelles. Une formule générale permet d’en déterminer le sens concret. La voici : ne pas prendre à la nature davantage que ce qu’elle peut reconstituer. C’est ce que nous avons appelé « la règle verte ».
Mais elle peut être convoquée d’une autre façon : ce serait en parlant de « mise en harmonie » avec la nature plutôt que de « domination » comme cela se pensa dans le passé. Alors on prendra ce que signifie le mot harmonie au pied de la lettre matérialiste : une synchronie de rythme. Ici la synchronie entre le cycle de la prédation et celui de la reconstruction.
Y parvenir tout en contentant les besoins des 7 milliards d’individus qui composent la population humaine sur la planète implique de nombreux changements. Tous les domaines sont concernés : mode de production, d’échanges et de consommation, hiérarchie des normes, ordre politique. C’est ce à quoi s’efforce de répondre le programme « L’Avenir en commun ». Je laisse donc la question du programme de côté à cet instant.
Je reviens à mon point de départ : ce que veut dire la référence à un « nouvel humanisme ». J’ai montré rapidement l’histoire de ce courant. Il s’agit de la reprendre à notre compte pour en assimiler la leçon essentielle qui reste notre fil rouge dans l’histoire. Il intègre non seulement l’histoire dans le temps long d’une idée mais aussi celle de toutes les luttes intellectuelles et sociales qui lui sont concomitantes. La « nouveauté » est que nous centralisons l’intérêt général humain en relation avec une nouvelle relation à l’écosystème. Celle-ci ne signifie pas seulement « respect » ou « protection » de l’environnement en vue de sa conservation. Il s’agit de passer à une attitude intellectuelle et pratique totalement refondée. Elle bouleverse jusqu’à la perception de soi. Au moins autant qu’a pu l’être en son temps l’idée d’un être humain émancipé se définissant par lui-même. S’émanciper de l’obscurantisme consumériste et de ses injonctions comme hier du plan divin et des ordonnances de sa cléricature.
Une fois de plus, il s’agit de passer d’un paradigme à un autre. Passer de celui de volonté de domination à celui de recherche d’harmonie. Domination ou harmonie ? Harmonie, bien sûr à condition d’entendre le mot dans le sens matérialiste que j’ai évoqué. La poésie vient par surcroît, c’est entendu. Et sans doute est-ce par elle que nous vient le goût de l’harmonie des mots organisant celle des choses.